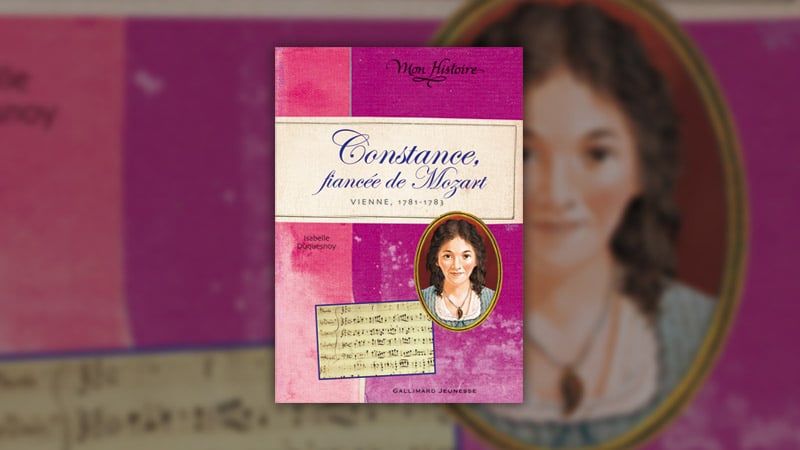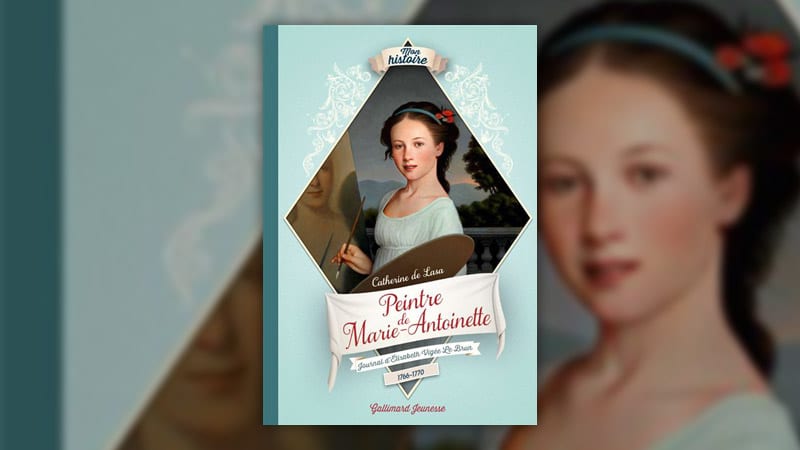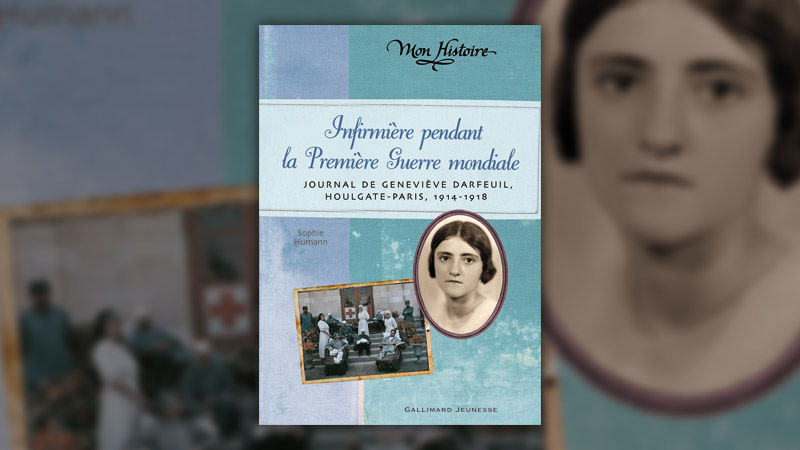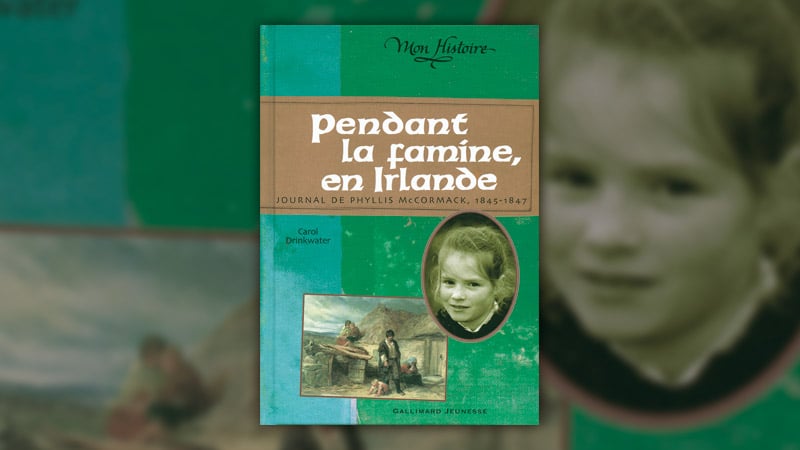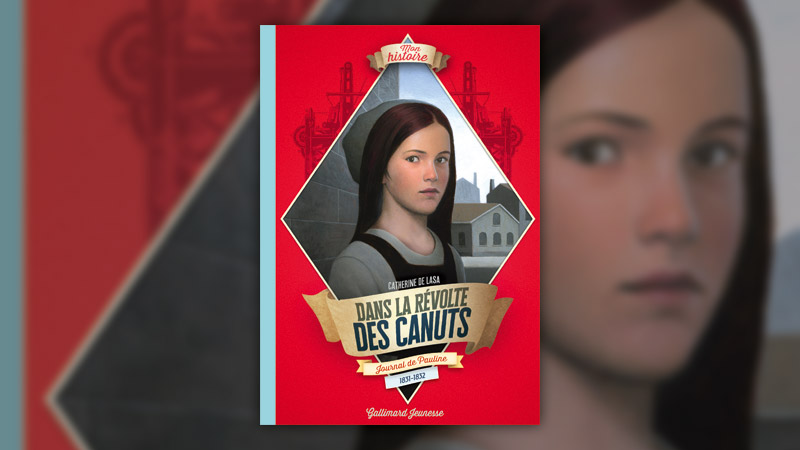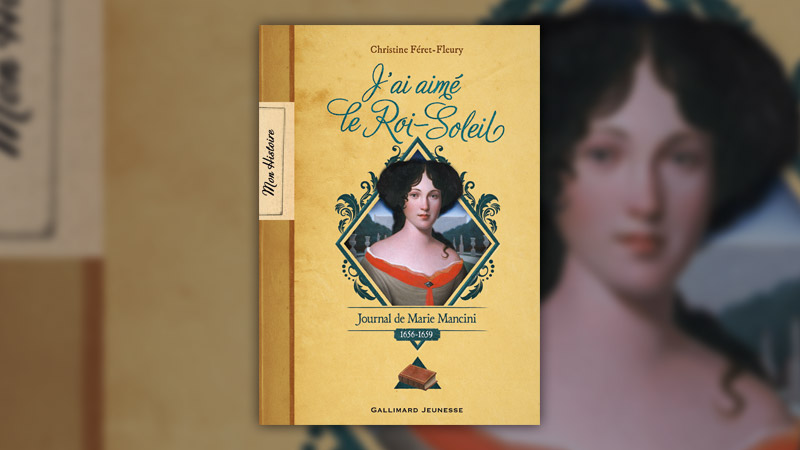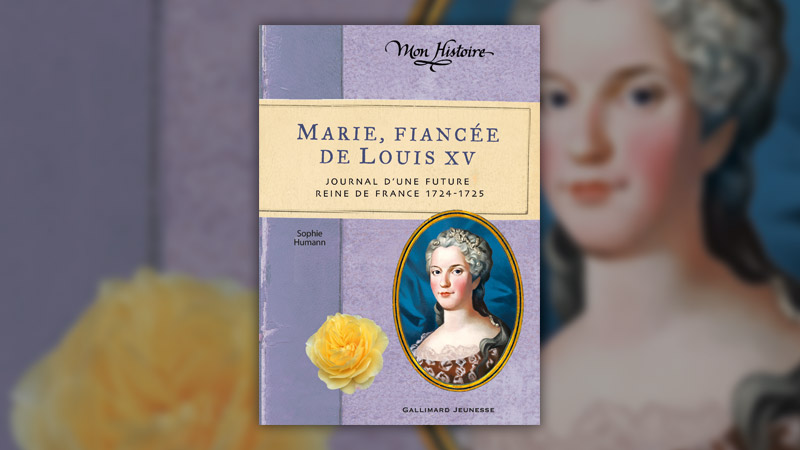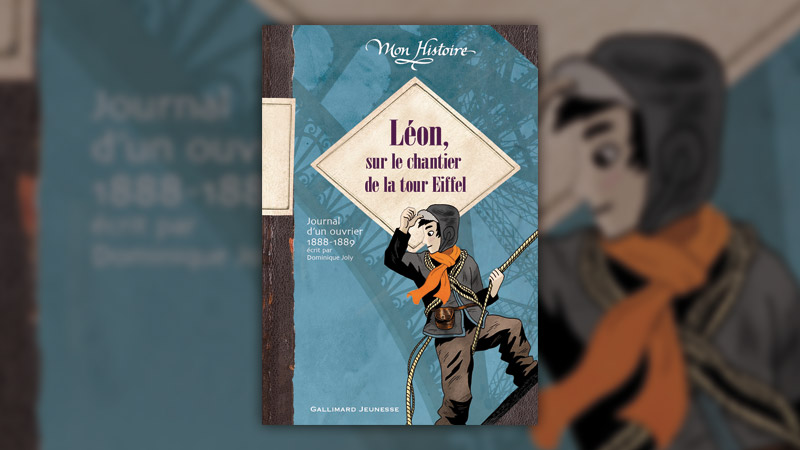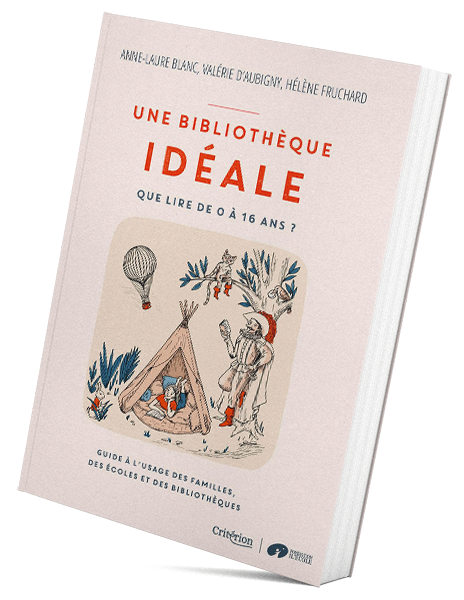Isabelle Duquesnoy, Constance, fiancée de Mozart
La jeune Constance, la troisième des quatre demoiselles Weber, tient son journal depuis le début de cette année 1781. Souvent malade, mal aimée de sa mère, dédaignée de ses sœurs, la jeune fille est pourtant remarquée par Wolfgang Mozart, qui l’épouse en 1782.